|
|
|
|
| Thèmes : |
développement durable
|
rapport
|
|
|
|
|
|
|
|
Dossiers et documents >
15 février 2008
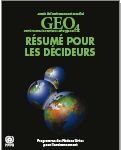
Programmes des Nation Unies pour l’environnement.
GEO4 : Avenir de l’environnement mondial
Résumé pour les décideurs.
Depuis 1997, le PNUE rédige des rapports sur l’Avenir de l’environnement mondial (GEO) qui mettent à disposition des évaluations concernant les interactions entre l’environnement et la société. Avec son mandat clé consistant à « garder l’environnement mondial sous surveillance », le PNUE a coordonné une série d’évaluations scientifiques comprenant
de nombreuses concertations et des procédés participatifs ayant contribué à la rédaction des rapports GEO en 1997, 1999 et 2002.
La quatrième évaluation, Avenir de l’environnement mondial : l’environnement au service du développement (GEO-4) est à ce jour le processus GEO le plus important. Il était destiné à assurer une synergie entre la science et la politique tout en conservant une crédibilité scientifique et en la rendant réceptive aux besoins et aux objectifs
politiques. Le lancement en 2007 du rapport GEO-4
coïncide avec le 20e anniversaire du lancement du
rapport de la Commission mondiale de l’environnement
et du développement, Notre avenir à tous. GEO-4 l’utilise
comme référence pour évaluer les progrès réalisés en vue
de répondre aux questions clés en matière d’environnement
et de développement. GEO-4 souligne le rôle essentiel de l’environnement dans le développement, et plus important encore, son rôle dans le bien-être humain.
GEO-4 est plus qu’un simple rapport : C’est également un processus consultatif important qui a débuté en 2004. En février de la même année, une consultation intergouvernementale sur le renforcement de la
base scientifique du PNUE, impliquant plus de 100 gouvernements et 50 organisations partenaires, a demandé un renforcement plus grand du processus GEO. La consultation mondiale a été suivie par des consultations régionales en septembre-octobre 2004, qui ont identifié
les questions environnementales essentielles au niveau régional et mondial. Fondés sur ces consultations, la portée, les objectifs et le processus du GEO-4 ont été finalisés et adoptés par la première consultation intergouvernementale et des parties en février 2005.
Extraits :
Environnement pour le développement
L’environnement durable est l’un des objectifs de développement essentiels pour atteindre les autres cibles.
La lutte contre l’extrême pauvreté et la faim, par exemple, dépend de l’agriculture durable qui, à son tour, repose sur les sols, l’eau et les processus écologiques.
De plus en plus, il est prouvé que l’investissement dans la gestion environnementale entraîne des revenus accrus pour les populations rurales pauvres. Cela peut également entraîner des revenus pour les industries dans les pays développés qui produisent des équipements de
réparation environnementale, par exemple au Danemark l’industrie environnementale constitue la deuxième plus grande source d’exportation.
On estime que 80 % de la population des pays en voie de développement dépendent des médecines traditionnelles et que la moitié des médicaments les plus fréquemment prescrits dans les pays développés, provient de sources naturelles.
Défis environnementaux et opportunités
- Atmosphère :
Les changements atmosphériques ont des impacts majeurs sur le bien-être humain. Depuis que Notre avenir à tous a mené une réflexion au sujet des changements climatiques, il y a eu une nette augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre et de la concentration de ces gaz dans l’atmosphère.
Les changements climatiques (y compris le réchauffement mondial) est en cours et on a enregistré une hausse de 0,74°C de la température
moyenne au siècle dernier.
Cette tendance qui a enregistré ces 12 dernières années (1995-2006) 11 années parmi les 12 les plus chaudes depuis 1850, est aujourd’hui pratiquement certaine. Les impacts sont déjà évidents et comprennent les changements de la disponibilité en eau, la propagation de vecteurs de maladie hydrique, la sécurité alimentaire, le niveau de la mer et la couverture neigeuse comme constaté avec la fonte de la calotte glaciaire du Groenland.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) anthropiques (principalement de CO2) sont le principal moteur du changement. L’augmentation prévue de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur, des tempêtes, des inondations et des sécheresses affecterait de façon spectaculaire des millions de personnes.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une augmentation de la température mondiale de 1,8 à 4° d’ici la fin du siècle.
Même si les concentrations atmosphériques en gaz à effet de serre
devaient être stables aujourd’hui, les températures des sols et des océans augmenteraient pendant des décennies et le niveau des mers pendant des siècles.
On estime que plus de 2 millions de personnes dans le monde meurent prématurément chaque année en raison de la pollution de l’air intérieur et extérieur.
Le "trou" de la couche d’ozone stratosphérique au-dessus de l’Antarctique, qui protège la population contre la menace des rayons ultraviolets, est aujourd’hui plus grand que jamais. A cause de la diminution des émissions des substances appauvrissant l’ozone (SAO) et sur la base du respect du Protocole de Montréal, on prévoit que
la couche d’ozone se reforme, mais pas avant 2060-2075 étant donné les longs décalages. Le protocole est un succès mondial provoqué, entre autres, par l’application d’incitations économiques, des investissements privés accrus et une sensibilisation renforcée du public.
- les sols :
L’utilisation non durable de l’eau et des terres, ainsi que les impacts du changement climatique entraînent la dégradation des sols, et notamment l’érosion, l’épuisement des nutriments, la pénurie d’eau, la salinité, la contamination chimique et la rupture des cycles biologiques.
Les effets cumulés de ces changements menacent la sécurité alimentaire, la biodiversité ainsi que la fixation et le stockage du carbone. Les populations pauvres subissent de manière disproportionnée les effets de la dégradation des sols, particulièrement dans les zones arides, où vivent quelque 2 milliards de personnes, dont 90% se concentrent sur les pays en voie de développement.
Plus de 100 millions de personnes vivent dans des zones situées à un mètre au-dessus du niveau de la mer maximum ; 21 des 33
mégalopoles du monde se trouvent dans des zones côtières, et la plupart d’entre-elles sont dans des pays en voie de développement.
Les problèmes d’organisation et la perte d’écosystèmes essentiels comme les zones humides, les mangroves et les barrières de corail,
ainsi que l’augmentation du niveau de la mer causée par le changement climatique, augmentent les risques d’inondations et rendent les côtes plus vulnérables aux tempêtes, aux tsunamis et à l’érosion.
- l’eau :
La contamination de l’eau demeure la cause principale des maladies et des décès à l’échelle planétaire. La disponibilité en eau douce par habitant diminue, et ce en partie à cause de prélèvements excessifs d’eaux de surface et souterraines.
En 2025, environ 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou régions souffrant d’un manque d’eau absolu, et les deux tiers de la population mondiale pourraient se trouver en situation de stress hydrique, les scénarios GEO-4 indiquant que plus de 5,1 milliards de personnes vivraient dans de telles conditions en 2050.
L’agriculture, qui est à l’origine de plus de 70 pour cent de la consommation de l’eau dans le monde, est une cible logique lorsqu’il s’agit de gérer la préservation. Le développement et la mise en place de la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) a amélioré le
bien-être de l’homme et de la santé des écosystèmes.
L’Eutrophisation des eaux intérieures et côtières causée par une charge nutritive excessive de sources comme les fertilisants agricoles tue les poissons de manière irrégulière et massive, et menace la santé des hommes ainsi que les moyens de subsistance.
La détérioration de la qualité des eaux intérieures et côtières est
amplifiée par d’autres polluants de sources terrestres, particulièrement, les eaux usées municipales et les écoulements urbains.
Les stocks de poissons d’eau douce subissent la dégradation d’habitat et les régimes thermiques relatifs aux changements climatiques et aux retenues d’eau.
- la biodiversité :
Le déclin de la biodiversité et la perte des services fournis pas les écosystèmes constitue toujours une importante menace pour l’avenir du développement dans le monde.
La réduction de la répartition et du fonctionnement des terres, de l’eau douce et de la biodiversité marine est plus rapide qu’à n’importe quelle période de l’histoire de l’homme. Les ecosystèmes tels que les forêts ainsi que les zones humides et arides sont en train de se transformer, et sont, dans certains cas, détériorés de manière irréversible.
Les taux d’extinction des espèces sont en augmentation. On considère que la diversité génétique des espèces, notamment agricoles, connait un déclin important.
En ce qui concerne l’agriculture, la biodiversité contribute à la regulation
et au maintien des services à travers la formation des sols, le cycle nutritif et la pollinisation. La biodiversité est la base de services culturels à travers ses attraits esthétiques et spirituels, ainsi que les valeurs
d’agrément de l’écotourisme.
Certaines estimations économiques sont disponibles, la valeur des services de régulation fournis par les abeilles comme pollinisateurs des cultures, a été estimée à plus de 2 milliards de US$ par an, et la valeur des captures en poissons à 58 milliards de US$ par an.
Si l’on considère l’importance de la biodiversité et le fait que les populations pauvres dans les zones retirées ont tendance à être plus directement affectées par la détérioration ou la perte de services fournis par l’écosystème, beaucoup de gouvernements ont établi et adopté les objectifs 2010 pour la biodiversité pour réduire les taux de perte de biodiversité au niveau mondial, régional et national.
Ces objectifs ont été adoptés par la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), et ils ont été approuvés lors du Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD). Cependant, au niveau mondial, et dans la plupart des régions du monde, la biodiversité continue à se réduire à cause des politiques actuelles et des systèmes économiques qui n’appliquent pas les valeurs de la biodiversité dans les systèmes politiques ou de marché, et la plupart des politiques déjà en place attendent d’être complètement mises en oeuvre.
Perspectives Régionales
Le bien-être de l’homme s’est considérablement amélioré au cours des 20 dernières années. Cependant, on compte encore 1 milliard de personnes démunies qui ne disposent pas des services essentiels
et ne sont pas protégés contre les changements environnementaux et socio-économiques.
- Région européenne :
L’Europe est une région possédant une importante diversité environnementale et socio-économique.
Des progrès ont été faits dans la dissociation des notions de croissance économique et d’utilisation des ressources, bien que la consommation des ménages ne cesse d’augmenter.
Depuis 1987, les émissions de GES émanant du secteur énergétique ont été réduits dans certains pays de l’Europe occidentale, même
si elles ont augmenté dans l’ensemble de la région.
Les émissions de polluants atmosphériques sont en grande partie provoquées par la demande de plus grande mobilité, notamment par l’utilisation accrue de transports privés et la détérioration des systèmes de transports publics dans de nombreux pays.
L’intensification et l’abandon des sols constituent les deux tendances majeures dans le secteur agricole qui ont un impact sur la biodiversité,
et qui entraînent un risque accru de désertification et dégradation des sols, particulièrement dans les régions du sud. L’infrastructure des transports fragmente les paysages et réduit la biodiversité.
L’utilisation d’instruments de marché dans les politiques environnementales a considérablement progressé en Europe, particulièrement concernant les taxes, les charges et des autorisations négociables. Les systèmes de redevances sur la pollution de l’air et l’eau ont été mis en place, et des taxes sur les déchets et l’utilisation
des ressources ont été appliquées. Des modèles de consommation et de production efficaces doivent être établis, et des enseignements et des mécanismes de bonne gestion sont maintenant échangés dans la
région, afin d’atteindre un développement durable.
- Région africaine :
La région continue d’être menacée par les déchets électroniques et dangereux étant donnée leurs lacunes concernant la surveillance et les mécanismes insitutionnels pour gérer de tels déchets.
En Afrique se trouvent moins 50 000 tonnes de pesticides obsolètes qui menacent à la fois la population et l’environnement.
Le manque de technologies respectueuses de l’environnement est un problème majeur en Afrique devrait être traité par le transfert de technologies, prenant en considération la préservation de l’héritage
culturel. Malgré les efforts pour gérer l’environnement grâce à la Conférence Ministérielle africaine sur l’Environnement (AMCEN), aux initiatives comme d’action environnementale du Nouveau Partenariat
le développement de l’Afrique (NEPAD), aux réformes agraires et agricoles ainsi qu’aux programmes de intégrée de l’eau et des sols, les politiques appliquées sont encore défaillantes et proposent des subventions agricoles qui ne sont pas équitables dans des régions
développées. Cela affaiblit la rentabilité et les moyens d’existence des petits propriétaires en Afrique.
- Région Asiatique et Pacifique :
La croissance rapide de la population, les changements des modèles de consommation associés à des revenus plus élevés ainsi que le développement urbain et industriel en pleine croissance sont à l’origine des changements environnementaux.
La pollution atmosphérique provoque la mort prématurée d’environ 500 000 personnes chaque année en Asie.
L’utilisation inefficace et excessive d’eau, la pollution industrielle, les modifications du climat et les désastres naturels sont les principales causes du stress hydrique.
Des changements rapides des modèles de consommation ont entraîné la production d’importantes quantités de déchets électriques et
électroniques, et de déchets dangereux et toxiques. Le trafic illégal de ces déchets entraîne de plus en plus de nouveaux défis. Même si la plupart des pays ont mis en place des lois, règlements et normes nationales considérables en matière d’environnement, et prennent part
à l’action internationale par le biais d’accords multilatéraux et bilatéraux, le défi est de faire appliquer ces lois et règlements
- Région Amérique Latine et Caraïbes :
La région de l’Amérique latine et des Caraïbes est la plus urbanisée des pays en voie de développement, avec 77% de la population totale qui vivent dans les villes et les taux d’urbanisation ne cessent d’augmenter.
La riche biodiversité dans la région est menacée par la conversion des forêts en pâturage, l’infrastructure et les zones urbaines.
Même si l’Amérique latine est responsable de seulement 5% des émissions de GES dans le monde et représente 8% de la population mondiale, les changements climatiques prévus menacent particulièrement la région. Parmi les impacts, figurent la hausse du niveau des mers,
des ouragans et des tempêtes plus fréquents , une augmentation des périodes de sécheresses et d’inondations associées à des phénomènes comme El Niño, la diminution de l’approvisionnement en eau
émanant des glaciers, ainsi que la réduction de la productivité de bétail et de céréales.
Le déclin de la qualité de l’eau, les changements climatiques et la
multiplication algale ont contribué à l’augmentation des maladies hydriques dans certaines régions côtières.
Les nouvelles politiques combinent ces approches avec des instruments économiques (notamment l’application du principe de "pollueur-payeur"). Les paiements pour les services fournis par l’écosystème sont mis en œuvre dans quelques pays (comme le Costa Rica, le Brésil, l’Equateur et le Mexique) pour protéger la biodiversité.
L’utilisation d’instruments économiques et le respect effectif des lois environnementales doivent être associées à une planification urbaine participative et orientée vers l’écologie, comme base stratégique de durabilité.
- Région américaine du nord :
La région est leader en matière de recherches de science et de rapports environnementaux, elle intègre le public dans sa prise de décision, met à disposition les informations sur les conditions environnementales et la production de biens et services qui atténuent ou empêchent les
dommages sur l’environnement.
Une base solide de la législation datant des années 1970, des programmes récents innovants basés sur le marché et des moyens pour payer les services fournis par l’écosystème
permettent d’entreprendre des initiatives pour contrôler la pollution et conserver les ressources naturelles.
Bien qu’elle ne représente que 5,1% de la population mondiale, l’Amérique du nord consomme plus de 24% des ressources
mondiales.
L’expansion urbaine soutenue et le développement exurbain en pleine croissance provoquent des pressions sur la qualité de l’air, la biodiversité et la pollution atmosphérique. (La plupart de villes canadiennes placent au premier plan le contrôle de l’expansion et, aux Etats Unis, 22 Etats ont mis en oeuvre des lois pour limiter l’expansion.)
La consommation d’eau par habitant est la plus élevée au monde, pourtant cela inclue l’importante quantité d’eau exportée, l’utilisation agricole représente 41% des prélèvements d’eau annuels aux Etats Unis et 12% au Canada. Les prélèvements excessifs des eaux souterraines
aux Etats Unis restent un défi. La qualité générale de l’eau
dans la région est la plus propre au monde. Pourtant, elle est très instable, environ 20% des bassins versants américains sont confrontés à des problèmes importants relatifs à la qualité de l’eau.
- Région d’Asie occidentale :
Une croissance de la population continue, les conflits militaires ainsi qu’un développement rapide ont mené à une augmentation sigtnificative du nombre et de l’importance des défis environnementaux et des pressions sur les ressources naturelles. L’Asie occidentale est une des régions du globe qui connaît le plus grand stress
hydrique. La disponibilité d’eau douce par habitant est un baisse, tandis que la consommation augmente. Les ressources en eau sont surexploitée, et 80 pourcents d’entre elles sont utilisées par l’agriculture.
Les réformes institutionnelles et politiques ont permis de renforcer l’attention sur un nécessaire déplacement du concept d’approvisionnement en eau à celui de gestion de la demande.
Des mesures permettant d’atténuer la dégradation des sols et de protéger les zones menacées ont été clairement définies au cours de plans d’action nationaux pour combattre lé désertification. Cependant, dans de nombreux pays, ces plans ne sont pas efficaces car ils
ne sont pas intégrés au politiques de développement socio-économique nationales.
Des politiques et mesures efficaces ont été mises en places dans plusieurs pays, telles que la suppression progressive de l’essence sans plom, adoption de politiques zérocombustion, la progression de l’utilisation du gaz naturel et la mise en place de système de gestion des déchets efficaces.
Les conflits armés ont eu un impact négatif sur le bien-être humain, ont fait accroître le nombre de réfugiés et ont conduit à une dégradation des ressources naturelles et des habitats écologiques.
- Régions polaires :
L’Arctique se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale, provoquant la réduction de la glace maritime.
Les polluants organiques persistants, bien qu’interdits dans
la plupart des pays industrialisés, sont toujours utilisés dans d’autres régions et s’accumulent au niveau des régions polaires, où ils pénétrent les écosystèmes marins et terrestres ainsi que les chaînes alimentaires. _ Ces substances toxiques menacent l’intégrité du système alimentaire
traditionnel et la santé de peuples indigènes de l’Arctique.
Le mercure résultant des émissions toxique représente également une menace car il peut être transporté sur une longue distance et transformé en méthyl-mercure, un Polluant Organique Persistant (POP).
Leçons et progrès des deux dernières décennies
Les changements environnementaux affectent les options de
développement humain, les populations pauvres étant les plus vulnérables.
Au cours des 20 dernières années, les risques naturels tels que les tremblements de terre, inondations, orages, cyclones tropicaux et ouragans, feux de forêt, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain ont emporté plus de 1,5 millions de vies et affectent
chaque année plus de 200 millions de personnes.
Entre 1992 et 2001, les inondations ont représenté la catastrophe naturelle la plus fréquente, faisant près de 100 000 morts et touchant plus d’1,2 milliard de personnes à travers le monde.
Des progrès ont été menés sur de nombreux fronts au cours des 20 dernières années. Le déclin historique des forêts tempérées a été inversé, certains problèmes régionaux de pollution atmosphérique,
tels que les pluies acides en Europe et en Amérique du Nord, ont été réglés avec succès, des avancées majeures ont été faites dans la recherche agricole, qui concernent des innovations permettant d’intégrer les concepts de conservation et de développement à la lutte contre la perte de la biodiversité, des inversions de la dégradation des sols et un renforcement de la durabilité environnementale.
On possède actuellement une expérience suffisante et substantielle
des instruments politiques qui peuvent être transférés, adaptés et implantés.
La coopération environnementale offre également des opportunités de créer des opportunités de paix, par la la promotion de l’utilisation partagée et durables des ressources entre les pays. L’Union Européenne offre un très bon exemple de la valeur ajoutée par une forte coopération politique entre les nations, en particulier dans la mise en place de réglementations environnementales concernant un grand nombre de
questions.
La régulation directe joue un rôle majeur dans la réalisation de progrès et doit continuer, même si l’utilisation des forces du marché et celle d’instruments non contraignants, tels que l’apport d’informations
et le transfert de technologies, jouent un rôle plus important que par le passé.
En compilant les réussites des différentes initiatives mondiales, régionales, sousrégionales et locales, le processus GEO peut permettre
de tirer un certain nombre de leçons des principes généraux de formulation et de mise en place de politiques publiques.
Les meilleures pratiques se développent de manière plus efficace
lorsqu’un contrôle des politiques et de leurs effets est mené. Pratiquement toutes les initiatives politiques réussies au cours des deux dernières années ont été soutenues par des programmes de contrôle environnemental solides. On ne peut que constater le manque de programmes de cette nature au regard des problèmes hautement
prioritaires identifiés dans le rapport GEO-4.
La prise de conscience de plus en plus forte des problèmes environnementaux et de meilleurs programmes d’éducation ont également mené au renforcement de la notion de responsabilité
sociale des entreprises (RSE). La RSE et le financement des entreprises de certaines activités sociales et environnementales ont été encouragés par les initiatives globales qui ont entraîné les entreprises à établir un compte rendu de leurs activités économiques mais également de leurs performances sociales et environnementales.
 scénarii : scénarii :
À travers l’exercice du scénario du GEO-4, les parties concernées ont découvert des interactions entre différents problèmes environnementaux concernant l’atmosphère, la terre, l’eau et la biodiversité.
Ces scénarios sont basés sur des hypothèses d’efficacité institutionnelle et sociopolitique, d’évolution démographique, de demande
économique, de mouvements des marchés et des échanges, d’innovations scientifiques et technologiques, de choix de valeurs, en matière de société et d’individu, et mettent en lumière ces zones d’incertitudes dans les décennies à venir.
Voici les quatre principaux éléments de ce scénario :
- Les marchés d’abord :
le secteur privé, grâce à un soutien gouvernemental actif, poursuit l’objectif de croissance le mieux adapté à une amélioration du
bien-être environnemental et humain pour tous. - La politique d’abord : le secteur gouvernemental, grâce à un soutien actif des secteurs privés et de la société civile, met en place de grandes
politiques destinées à améliorer l’environnement et le bien-être humain, tout en continuant à poursuivre ses objectifs de développement économique.
- La sécurité d’abord : Le secteur gouvernemental et le secteur privé se concentrent sur les efforts destinés à améliorer, ou du moins à maintenir, le bien-être humain pour les riches et les puissants au
sein de la société.
- La durabilité d’abord : les secteurs gouvernementaux et privés ainsi que la société civile travaillent en collaboration à l’amélioration
de l’environnement et du bien-être humain pour tous et placent l’équité au centre de leurs devoirs.
Aller de l’avant
Les institutions existantes sont vitales dans la création de conditions correctes pour le changement. Des réalisations plus importantes peuvent résulter d’une approche complémentaire en deux volets :
- Renforcer les institutions et les politiques d’adaptation qui ont déjà prouvé leur efficacité face aux problèmes conventionnels dans des
domaines où de telles politiques sont absentes, en particulier dans les régions en développement, et financer cet effort ;
- Soutenir l’innovation et la recherche de solutions nouvelles et émergentes pour les problèmes environnementaux persistants, en se servant des instruments économiques et des instruments d’approche mieux adaptables.
Quand une nouvelle approche fonctionne bien, qu’il s’agisse de gestion forestière, de techniques d’irrigation ou de protection d’espèces menacées, les leçons tirées au cours de son processus de mise en place peuvent permettre d’établir un nouveau standard pour de meilleures pratiques dans l’ensemble du secteur. Même si ces pratiques n’apportent pas la totalité de la réponse à un problème environnemental, elles peuvent représenter des avancées importantes vers de nouvelles solutions.
Les expériences tirées d’initiatives globales, nationales et
locales qui s’adressent aux questions environnementales les plus complexes ont également permis de tirer plusieurs leçons de principes généraux de formulation et de mise en place de politiques publiques. Afin d’améliorer leurs chances de succès, les décideurs politiques devraient :
- Stimuler la volonté politique par la prise de conscience publique, l’éducation et les systèmes de médiation de conflits ;
- Créer les bases législatives et l’environnement judiciaire nécessaires, réduire les délais entre les décisions politiques et leur application et s’assurer que les systèmes de financement durable sont protégés de toute corruption ;
- Renforcer les compétences des agences et des équipes opérant au niveau local, national et international ;
- Décentraliser le pouvoir jusqu’au niveau de décision approprié le plus bas, ce qui généralement permet de gagner plus de temps et a plus de sens ;
- Impliquer les parties concernées compétentes, par exemple à travers des partenariats formels ou informels, et transférer l’autorité vers les parties qui ont les meilleurs positionnements et compétences
pour la prise en charge des responsabilités ;
- Soutenir et faciliter la participation active des femmes, des communautés locales, des groupes marginalisés et vulnérables ;
- Soutenir la recherche, le contrôle et la mise en place de réseaux d’information et développer des objectifs de gestion spécifiques, sélectionner les indicateurs appropriés et mesurables ainsi que gérer
et évaluer les progrès au sein de ces objectifs.
Des appels pour la création d’une Organisation Mondiale de l’Environnement ont été lancés dès le début des années 1970. Le débat sur la nécessité d’une telle organisation et sur les formes qu’elle pourrait prendre est toutefois toujours en cours.
Le renforcement de la connaissance environnementale concernant les interactions entre populations et environnement à tous les niveaux, basé sur les meilleures recherches et données scientifiques disponibles peut être réalisé en améliorant l’infrastructure et les compétences dans le domaine des connaissances, en assurant la promotion de systèmes de données et d’outils interopérables, et par le partage de l’information, en particulier dans les régions en développement. (Apprendre quelles sont
les meilleures pratiques peut être facilité, par exemple, par la mise en place de plateformes et réseaux d’apprentissage en ligne.)
On peut également voir apparaître certains bénéfices environnementaux et économiques suite à la suppression progressive de certaines
subventions. Par exemple, une étude de l’AIE concernant la suppression des subventions à la consommation d’énergie dans huit pays en développement est arrivée à la conclusion que leur croissance économique annuelle augmenterait de plus de 0,7 % alors que les émissions de CO2 diminueraient de presque 16 % (AIE, 1999). La
création de budgets verts, de fonds de conservation et d’instruments économiques, tels que les charges et taxes destinées aux utilisateurs, font partie des outils qui ont été mis en place dans de nombreux pays.
Réduire la vulnérabilité peut impliquer un renforcement des droits locaux en développant, par exemple, les formes institutionnelles plus à l’écoute
des problèmes locaux ou en renforçant la titularisation des ressources permettant aux populations de sécuriser l’accès aux qualités de leurs conditions de vie ainsi qu’en renforçant le contrôle de l’utilisation de ces
ressources.
L’autonomisation des femmes contribue non seulement à l’objectif commun d’équité et de justice, mais présente aussi un intérêt économique, environnemental et social. On a pu prouver que les plans destinés aux femmes bénéficient de retours supérieurs et plus
durables.
Les scénarios sur les futurs changements environnementaux suggèrent que l’implantation immédiate d’actions déterminées est moins coûteuse
que d’attendre la création de meilleures solutions.
Retarder la mise en place des actions revient également à transmettre son poids et son prix aux générations futures et contredit le principe d’équité intergénérationnelle. En particulier, les derniers rapports de l’IPCC sur les coûts de l’inaction dans le domaine des changements climatiques ont tiré la sonnette d’alarme en mettant l’accent sur la nécessité d’agir, et suggèrent que de nombreux pays peuvent se permettre financièrement de mettre en place des mesures immédiates.
Des approches innovantes sont nécessaires afin que la société engage une transition nécessaire vers une économie durable, faible
utilisatrice de carbone.
En matière de politique, les options disponibles permettant d’influencer les facteurs économiques comprennent les taxes vertes, la création de marchés pour les écoservices et la gestion environnementale.
Les gouvernements commencent à acquérir de l’expérience dans l’implantation de ces instruments, bien que ce soit à des niveaux relativement bas.
Apprendre par l’action peut aider à développer de nouvelles approches politiques permettant de déplacer les décisions concernant le développement dans une direction plus durable.
À travers la réforme des taxes écologiques et le déplacement des taxes, les taxes sur l’utilisation de l’énergie et la consommation d’autres ressources ont augmenté, et des réductions correspondantes sont
généralement appliquées aux impôts sur le revenu. Bien que ce procédé ait du faire face à une forte résistance, les réformes des taxes écologiques ont prouvé qu’elles étaient un puissant moteur d’innovation
et représentaient de nouvelles opportunités d’emploi.
Lorsqu’elles sont établies de manière progressive et qu’elles sont sans incidence sur les recettes et faciles à appliquer, ces réformes peuvent encourager des modes de consommation sensibilisés à l’environnement
sans causer d’effets négatifs importants de redistribution
sociale.
Une approche relativement nouvelle appelée paiement pour les services environnementaux ou écosystémiques (PES) tente de répondre à la surexploitation des écosystèmes en payant des individus et les communautés qui sécurisent l’approvisionnement en écoservices.
Bien que le maintien des objectifs puisse être louable, l’altération de la nature commerciale des subventions agricoles devrait également être prise en considération.
Conclusion
Les défis liés qui s’adressent tant au développement qu’à l’environnement dont Notre Avenir à Tous avait présenté la
menace en 1987 sont toujours d’actualité, comme le sont les défis politiques associés. La connaissance des liens entre environnement et développement et ses impacts sur le bien-être humain, acquis au cours des deux dernières décennies, peuvent être utilisés de manière efficace comme des outils de transitions vers un développement durable. Les questions relatives à l’environnement mondial ont pu atteindre elles-mêmes un point de basculement avec la prise de conscience accrue que, pour la plupart des problèmes, les bénéfices d’une action précoce dépassent les coûts.
Aujourd’hui, le moment est venu de s’engager plus
en avant dans une transition vers un développement durable soutenu par des institutions bien gouvernées, innovantes et tournées
vers les résultats, qui seule pourra répondre de manière efficace aux défis environnementaux, en particulier les plus persistants.
 Télécharger le "Résumé pour les décideurs" Télécharger le "Résumé pour les décideurs"
|

